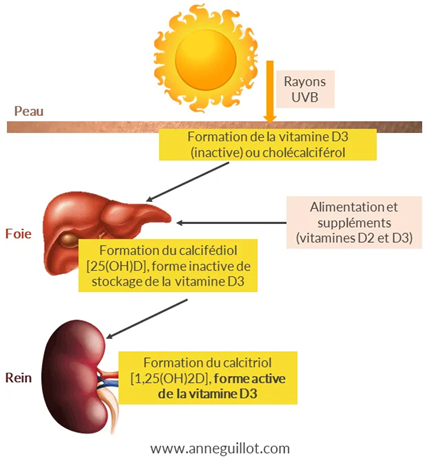La vitamine D est reconnue pour son rôle dans le renforcement des os et la régulation du calcium dans le corps. Cependant, elle intervient également dans le fonctionnement de nombreuses cellules, y compris les cellules cancéreuses (Spina, 2006).
Des recherches montrent que les cellules cancéreuses possèdent des récepteurs à la vitamine D et cette vitamine D agit sur plus de 200 gènes, dont certains sont impliqués dans le développement du cancer.
Mécanismes anticancéreux potentiels de la vitamine D
La vitamine D pourrait agir de plusieurs façons pour limiter le développement des cancers (NIH, 2025) :
- En ralentissant la multiplication des cellules cancéreuses,
- En réduisant la formation de vaisseaux sanguins qui alimentent les cellules cancéreuses,
- En limitant la transformation des cellules précancéreuses en cellules cancéreuses,
- En favorisant la mort programmée (apoptose) de certaines cellules cancéreuses.
Incidence totale du cancer et mortalité
Certaines études observationnelles ont mis en évidence une association entre un faible taux de 25(OH)D et une augmentation du risque de développer un cancer, ainsi qu’une hausse de la mortalité liée au cancer.
Une méta-analyse regroupant 16 études sur la mortalité et 8 sur l’incidence de cancer a montré que chaque augmentation de 20 nmol/L du taux de vitamine D dans le sang était associée à :
- Une diminution de 7% du risque de développer un cancer,
- Et une réduction de 2% du risque de décès par cancer.
Cependant, il est important de noter que toutes les études observationnelles n’ont pas mis en évidence cette association. Les résultats varient selon les populations étudiées, les pathologies prises en compte, et les méthodes de mesure du taux de vitamine D.
Concernant les études cliniques, deux études importantes ont été menés pour observés les effets de suppléments de vitamine D sur le cancer.
L’essai clinique américain VITAL a étudié les effets de la supplémentation en vitamine D sur la prévention primaire du cancer dans la population générale.
- Les participants ont reçu soit 50 mcg de vitamine D3 par jour, soit un placebo, pendant 5 ans.
- Les résultats n’ont pas montré de différence significative dans le nombre de cas de cancer du sein, de la prostate ou du côlon entre les deux groupes (Manson, 2019).
De manière similaire, l’étude Women’s Health Initiative (WHI) a observé les effets d’une supplémentation quotidienne en vitamine D3 de 10 mcg associée à 1000 mg de calcium par rapport au placebo, chez plus de 36000 femmes ménopausées.
- Après 7 ans de suivi, aucune différence significative n’a été observée concernant l’incidence ou la mortalité liée au cancer.
- Cependant, une analyse à long terme (sur un peu plus de 22 ans) a montré une réduction d’environ 7% de la mortalité par cancer chez les femmes ayant reçu la supplémentation, sans impact sur l’incidence des cancers (Thomson, 2024).
Cancer du sein
Une étude française menée à l’Inserm à Gustave Roussy, sur près de 2 000 femmes, a montré que les femmes ayant un taux élevé de vitamine D (supérieur à 30ng/mL) avaient un risque réduit de 27 % de développer un cancer du sein par rapport aux femmes ayant un taux faible (inférieur à 20 ng/mL). Ils concluent à une association entre la vitamine D et le risque de cancer sein et recommandent aux femmes de veiller à maintenir un taux suffisant de vitamine D (Engel, 2010).
L’effet protecteur de vitamine D dans le sang semble particulièrement marqué chez les femmes préménopausées (Estébanez ; 2018).
Les essais cliniques évaluant la supplémentation de vitamine D n’ont pas apporté de preuve significative d’une réduction du risque de cancer du sein (Li, 2021).
Cancer colorectal
Une grande étude cas-témoins a inclus 5706 personnes ayant développé un cancer colorectal et 7105 témoins.
- Les taux de vitamine D ont été mesurés en moyenne 5,5 ans avant le diagnostic.
- Les résultats indiquent qu’un taux de vitamine D inférieur à 30 nmol/L était associé à un risque de cancer colorectal augmenté de 31%.
- Tandis que les taux plus élevés étaient associés à un risque plus faible de cancer colorectal.
- Cette association était plus forte chez les femmes (McCullough, 2019).
Dans l’étude clinique Women’s Health Initiative, la supplémentation en vitamine et calcium n’a pas modifié le taux de cancer colorectal (Wactawski-Wende, 2006).
D’autres part une étude menée sur 2 259 personnes âgées ayant eu un ou plusieurs polypes sillonnés (lésions précancéreuses) retirés.
- Les participants avaient reçu des doses quotidiennes de vitamine D3 ou de calcium ou les deux ou un placebo pendant 3 à 5 ans, suivi d’une observation de 3 à 5 ans après l’arrêt du traitement (6 à 10 ans au total).
- La vitamine D seule n’a pas significativement modifié le développement de nouveaux polypes sillonnés.
- En revanche, la combinaison de vitamine D et calcium a multiplié par presque 4 le risque de nouveaux polypes (Crockett, 2019).
L’essai clinique VITAL n’a trouvé aucune association entre la supplémentation en vitamine D et le risque de cancer colorectal (Song, 2020).
Cancer de la prostate
Les résultats sont partagés quant au lien entre les taux de vitamine D et le risque de cancer de la prostate.
Une méta-analyse de 21 études (11 941 cas et 13 870 témoins) a montré un risque accru de 17% chez les hommes ayant des taux élevés de vitamine D (Xu, 2014).
Une autre étude sur 4 733 hommes a observé un risque plus faible de cancer de la prostate chez ceux avec un taux de vitamine D entre 45 et 70 nmol/l comparé à ceux avec un taux plus élevé ou plus faible. Cette observation était d’autant plus importante pour les formes plus agressives de cancer (Kristal, 2014).
Enfin, une autre étude avec 1 695 cas et 1 682 témoins n’a trouvé aucune relation entre les taux de vitamine D et le risque global de cancer de la prostate (Schenk, 2014).
Des études plus récentes, dont une méta-analyse de 19 études, n’ont trouvé aucun lien clair entre :
- Une carence en vitamine D et le risque accru de cancer
- Des taux plus élevés de vitamine D et un risque réduit (Travis, 2020).
De manière similaire, une étude menée chez 1 119 hommes suivis sur 5 à 9 ans après diagnostic n’a montré aucun lien entre les taux de vitamine D et
- Le risque de décès par cancer de la prostate
- Le risque de décès toutes causes confondues (Nair-Shalliker, 2020)
Cependant, une méta-analyse de 7 études sur 7 808 hommes atteints a révélé que des taux plus élevés de vitamine D étaient associés à
- Une réduction de 9% de la mortalité par cancer de la prostate
- Une réduction de 9% de la mortalité toutes causes confondues (Song, 2018).
Les analogues de la vitamine D
Des travaux sont en cours sur des formes modifiées de la Vitamine D, appelées analogues, qui viserait à conserver ou renforcer les effets anticancéreux tout en limitant les effets secondaires, notamment l’hypercalcémie (Dallavalasa, 2024). Ces composés montrent un potentiel intéressant in vitro et dans certains modèles animaux, où ils peuvent prévenir le développement du cancer. Cependant, leurs effets dans les essais cliniques restent encore à confirmer (Giammanco, 2014).