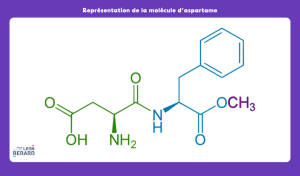1965 : Découverte fortuite de l’aspartame par un chimiste du laboratoire américain Searle.
1974 : Aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) autorise l’utilisation de l’aspartame dans les aliments solides.
Certains chercheurs critiquent la méthodologie des études toxicologiques menées par le laboratoire Searle et suggèrent, entre autres, le rôle potentiel de l’aspartame dans le développement de tumeurs cérébrales chez le rat.
1975-1980 : La FDA suspend l’autorisation de mise sur le marché de l’aspartame et rassemble un comité scientifique indépendant, le Public Board of Inquiry (PBOI), pour ré-évaluer la toxicité de l’édulcorant. Le PBOI conclut qu’il est nécessaire de mener des études supplémentaires et recommande d’interdire l’utilisation de l’aspartame.
1981 : Un Comité mixte d’experts de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation Mondiale de la santé (OMS) sur les additifs alimentaires, appelé JECFA, estime que les données sont insuffisantes pour prouver la toxicité de l’aspartame. Une dose journalière admissible (DJA) de 40 mg/kg de poids corporel est tout de même fixée.
1981 – 1996 : La FDA réautorise l’utilisation de l’aspartame en 1981, contournant ainsi la décision du PBOI. Aux Etats-Unis, l’aspartame est progressivement adopté dans plusieurs produits malgré les nombreuses objections.
1994 : Après évaluation par l’European Food Safety Authority (EFSA), l’Union Européenne autorise l’aspartame (1988 en France). Il est alors codé E-951 dans la classification européenne des additifs alimentaires.
Plusieurs études (Olney, 1996 ; Soffritti, 2005, 2006, 2007, 2010) suggèrent un lien possible entre l’aspartame et un risque accru de tumeurs cérébrales, de leucémies et de lymphomes. Une étude danoise (Halldorsson, 2010) met en évidence une association entre la consommation de boissons contenant des édulcorants et un risque d’accouchement prématuré chez les femmes enceintes. Toutefois, ces travaux sont critiqués pour leur manque de rigueur méthodologique, et leurs conclusions sont rejetées par la FDA et l’EFSA.
2011 : L’Agence nationale française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) évalue les risques et bénéfices nutritionnels de l’ensemble des édulcorants intenses. Aucun avantage significatif n’est démontré en matière de contrôle du poids, de réduction du risque de diabète de type 2, ou de régulation de la glycémie chez les personnes diabétiques.
2013 : Sur une demande de la Commission européenne, l’EFSA entreprend une évaluation exhaustive de toutes les données disponibles sur l’aspartame. La conclusion reste inchangée : l’aspartame est défini comme sûr aux doses actuelles (DJA).
De nouvelles études épidémiologiques de grande qualité font état d’une association entre la consommation de boissons édulcorées et l’incidence du cancer du foie ou la mortalité par cancer du foie (Stepien, 2016 ; Jones, 2022 ; McCullough, 2022). Une étude épidémiologique française met en évidence un lien entre la consommation d’édulcorants et un risque accru de cancer du sein, de cancer lié à l’obésité et de cancer en général (Debras, 2022). Des travaux expérimentaux menés sur des souris identifient également une activité cancérogène de l’aspartame (Gnudi, 2023).
L’effet potentiel de l’aspartame sur le fonctionnement métabolique et notamment sur l’incidence du diabète de type 2 (Fagherazzi, 2016 ; Zhou, 2022) ou sur le microbiote intestinal (Nettleton, 2020) est aussi suggéré.
2023 : Compte tenu de ces nouveaux résultats de recherche, l’effet de l’aspartame sur la santé est ré-évalué en priorité par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et le JECFA.
- Le CIRC classe l’aspartame comme potentiellement cancérogène pour l’humain (Groupe 2B des Monographies du CIRC), évoquant des « indications limitées » de cancérogénicité chez l’humain, tout en confirmant l’innocuité de l’aspartame aux doses recommandées.
- Le JECFA évalue les expositions moyennes et maximales à l’aspartame dans la population générale, et conclut que l’exposition à l’aspartame ne pose pas de problème de santé en respectant la DJA existante (40 mg/kg de poids corporel).
Quelques chiffres pour illustrer :
- Pour un adulte de 70 kg, la limite maximale journalière est d’environ 2 800 mg d’aspartame (40 mg x 70 = 2800 mg). Le dépassement de cette DJA reviendrait donc à consommer tous les jours plus de 9 canettes de soda (contenant 300 mg d’aspartame chacune), en supposant le reste de l’alimentation exempt d’aspartame.
- En 2014, la consommation moyenne d’aspartame en France a été estimée à 2 % de la DJA.