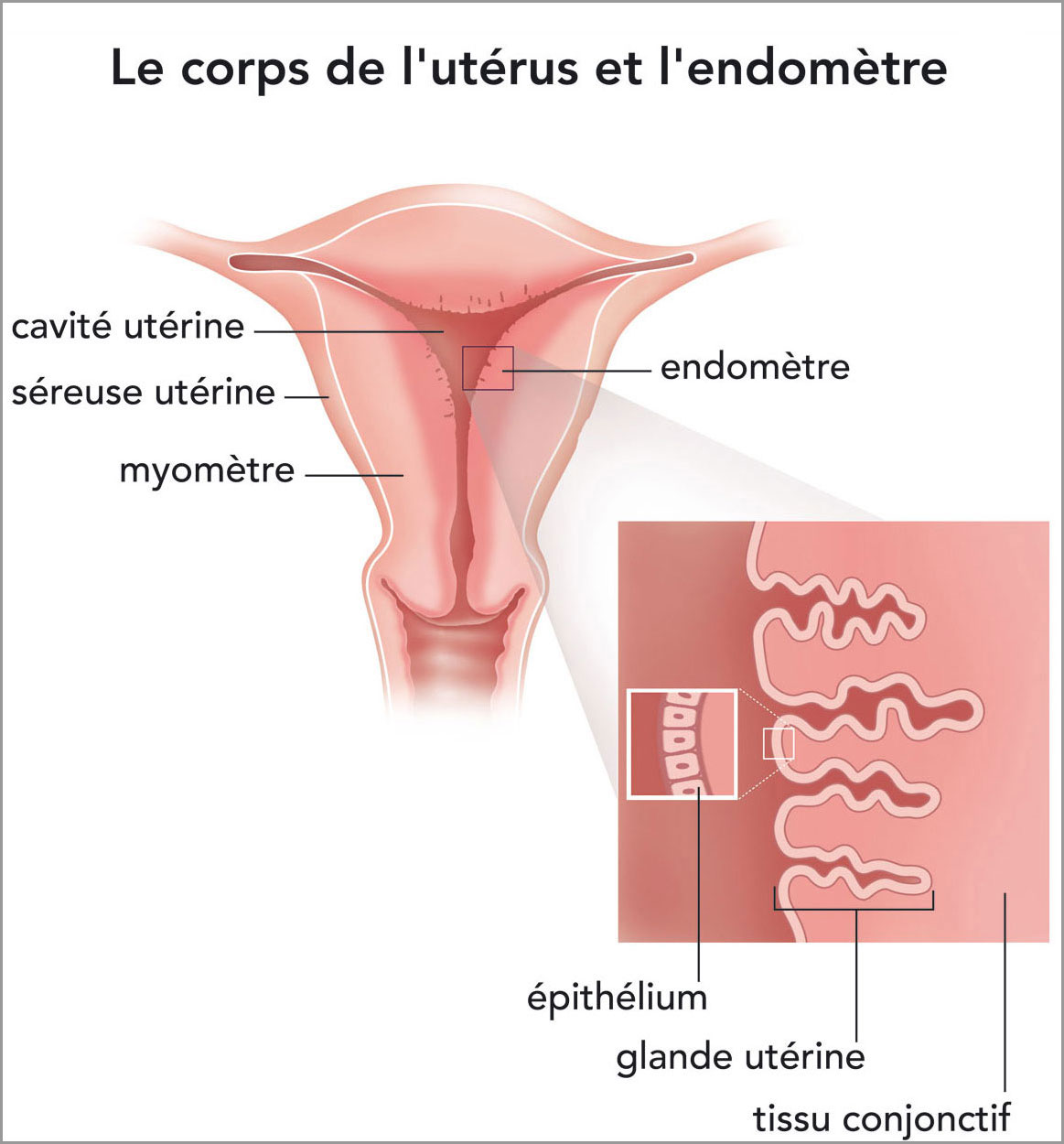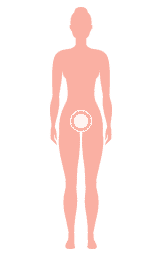Le CIRC s’est intéressé à l’identification des expositions environnementales, professionnelles ou comportementales cancérogènes. Cette classification n’inclut pas certains facteurs individuels tels que l’histoire familiale, la génétique, le statut hormonal et reproducteur qui ont souvent un rôle majeur. Les facteurs de risques avérés sont ceux pour lesquels les données disponibles sont suffisantes pour conclure avec certitude à l’existence d’un lien avec le cancer de l’endomètre.
Facteurs de risques individuels
L’âge
Comme pour la plupart des cancers, l’âge est un facteur de risque important de cancer de l’endomètre : plus une femme vieillit, plus son risque augmente. Il touche généralement les femmes après la ménopause. Le risque est maximal autour de 70-74 ans et l’âge médian au diagnostic est de 69 ans (INCa, 2019).
La génétique
L’histoire familiale de cancer de l’endomètre représente un facteur de risque important. Les femmes ayant une apparentée atteinte au premier ou au second degré auraient un risque 3,3 fois plus élevé (Bharati, 2014). L’augmentation du risque associée aux antécédents familiaux peut être le fait de facteurs environnementaux (partage d’un même mode de vie) mais également de facteurs génétiques héréditaires (Sénéchal, 2015).
Environ 2 à 5 % des cancers de l’endomètre surviennent dans un contexte de prédisposition génétique (INCa). La plus fréquente est le syndrome de Lynch, cette maladie augmente le risque de nombreux cancers (colorectal, endomètre, ovaire…). Les 2 gènes principalement retrouvés (MLH1 et MSH2) jouent un rôle important dans la réparation de l’ADN, leur transmission est autosomique dominante [qui se transmet à 50% de la descendance]. Il s’agit alors de formes familiales de tumeur de l’endomètre, qui apparaissent à un âge plus précoce (avant 50 ans), une surveillance de l’endomètre est alors recommandée dès l’âge de 30 ans (Association HNPCC – LYNCH).
L’exposition aux hormones naturelles au cours de la vie
La durée d’exposition aux œstrogènes naturels est définie par la période entre la ménarche et la ménopause. En augmentant cette durée, la puberté précoce et la ménopause tardive sont des facteurs de risque.
Selon une étude récente (Wu, 2019), le risque de développer un cancer de l’endomètre, par rapport à une femme ménopausée avant l’âge de 46.5 ans est :
- 1,17 fois plus élevé chez une femme ménopausée à 50 ans ;
- 1,57 fois plus élevé chez une femme ménopausée à 54 ans ;
- 2,08 fois plus élevé chez une femme ménopausée à 57 ans.
A l’inverse, la puberté tardive est protectrice, le risque est environ 0,7 fois moindre en cas de premières règles à plus de 15 ans (Sénéchal, 2015).
Différents facteurs sont liés aux changements hormonaux pendant la grossesse. A la fois, car la sécrétion d’œstrogènes est moindre pendant la gestation comparativement aux cycles menstruels en l’absence de grossesse et également car la production de progestérone, qui a un effet protecteur sur l’endomètre, est plus élevée (Raglan, 2019). La nulliparité est donc un facteur de risque. A contrario, toute grossesse, même non menée à terme, semble être protectrice (Husby, 2019). Chaque nouvelle naissance au-delà de la seconde serait associée à une réduction du risque de 10 % (Dossus, 2010). Par ailleurs, les grossesses tardives auraient un effet protecteur plus marqué. En effet, une exposition prolongée à la progestérone pendant la grossesse serait particulièrement bénéfique chez les femmes plus âgées (Sénéchal, 2015).
A noter que l’allaitement et de surcroit l’allaitement prolongé, semblent réduire d’environ 11 % le risque de tumeur de l’endomètre (Jordan, 2017).
L’infertilité, lorsqu’elle est liée à des troubles de l’ovulation, apparait aussi comme un facteur de risque de cancer de l’endomètre, avec une augmentation du risque variable (1,25 à 3) selon les études (Lundberg, 2019 ; Renaud, 2018). La contraception hormonale oestroprogestative permet, quant à elle, de réduire le risque de cancer de l’endomètre (Collaborative Group on Epidemiological Studies on Endometrial Cancer, 2015).
Le traitement hormonal de la ménopause (THM)
Le CIRC a établi que le risque de cancer de l’endomètre est augmenté chez les femmes prenant un traitement oestrogénique de la ménopause. Ce risque diminue mais reste tout de même augmenté lorsque le traitement est oestroprogestatif et que la progestérone est prise moins de 15 jours par mois (CIRC/IARC, 2012). Alors que l’inverse semble être observé dans le cancer du sein : le traitement oestroprogestatif augmente davantage le risque de cancer que le traitement oestrogénique seul (Green, 2019).
En France, en 2015, 393 nouveaux cas de cancer de l’endomètre (soit 13 %) seraient attribuables à l’utilisation d’un THM (CIRC, 2018).
Il est important de noter que depuis les années 2000, la prescription du THM a évolué et est maintenant bien codifiée. De la progestérone est maintenant systématiquement associée aux œstrogènes, au minimum 12 jours par mois, chez les femmes qui n’ont pas eu d’hystérectomie. De plus, une durée de prise limitée à 5 ans est recommandée, avec une réévaluation annuelle de son indication et en cas de saignements gynécologiques anormaux, il est indispensable de consulter son médecin pour éliminer un problème utérin (GEMVI, 2017).
A noter que les dernières données semblent rassurantes concernant l’utilisation de gel vaginal à base d’œstrogène dans le traitement du syndrome génito-urinaire de la ménopause et le risque de cancer de l’endomètre (Pinkerton, 2017).
Le tamoxifène
Le tamoxifène est un traitement donné chez les femmes avec un cancer du sein et dont la tumeur présente une sensibilité aux hormones (œstrogènes, progestérone). Ce traitement hormonal, qui pourtant a un rôle anti-œstrogène, a été reconnu comme cancérogène avéré pour l’endomètre (CIRC/IARC, 2012). En effet, il possède un effet stimulant « paradoxal » sur l’endomètre, qui peut favoriser le développement d’un cancer. Ce risque est environ 2,5 fois plus élevé pour une prise de tamoxifène pendant 5 ans (Sénéchal, 2015). Néanmoins, pour ces femmes avec un cancer du sein, le bénéfice de ce traitement (qui permet de diminuer le risque de récidive) est supérieur au risque de cancer de l’endomètre et justifie son utilisation. Un suivi gynécologique rigoureux est nécessaire en cas de traitement par Tamoxifène.
Facteurs de risque comportementaux
Le surpoids, l’obésité
Le surpoids, l’obésité sont généralement diagnostiqués par l’IMC:
- Entre 25,0 et 29,9 kg/m², il existe un surpoids ;
- Entre 30,0 et 34,9 kg/m², il s’agit d’une obésité modérée (grade 1) ;
- Entre 35,0 et 39,9 kg/m², il s’agit d’une obésité sévère (grade 2) ;
- Plus de 40 kg/m², il s’agit d’une obésité massive (grade 3).
En 2015, en France, il a été estimé que 2546 cas de cancer de l’endomètre (soit 34 %) seraient attribuables au surpoids et à l’obésité (CIRC, 2018).
Le CIRC (CIRC, 2016) estime que le risque de développer un cancer de l’endomètre, par rapport à une femme qui a un IMC normal serait :
- 1,5 fois plus élevé chez une femme en surpoids ;
- 2,5 fois plus élevé chez une femme avec une obésité de grade 1 ;
- 4,5 fois plus élevé chez une femme avec une obésité de grade 2 ;
- 7,1 fois plus élevé chez une femme avec une obésité de grade 3.
Les mécanismes pour expliquer cette relation entre adiposité et cancer de l’endomètre sont multiples. Le tissu adipeux est un des principaux sites de synthèse des œstrogènes (notamment chez la femme ménopausée). Or l’augmentation du taux d’œstrogènes est fortement associée au risque de cancer de l’endomètre. De plus l’obésité augmente le taux de certaines hormones (insuline, leptine) qui peuvent favoriser la croissance des cellules cancéreuses (WCRF, 2018).
La taille élevée des femmes apparait aussi comme associée à une augmentation du risque de cancer de l’endomètre, mais ce n’est pas la taille elle-même qui est en cause. En réalité, ce sont les facteurs qui conduisent à une croissance élevée (reflétée par la taille atteinte à l’âge adulte) qui sont responsables d’une augmentation du risque de cancer de l’endomètre (WCRF, 2018).
Le diabète
Le diabète est associé à risque augmenté de développer un cancer de l’endomètre (Giovannucci, 2010). Cette maladie se caractérise par une hyperglycémie. Le taux sanguin de glucose est régulé par une hormone appelée insuline. Il existe 2 principaux types de diabète, dus à des dysfonctionnements différents (Ameli, 2019).
Le plus fréquent, le diabète de type 2 est dû à une mauvaise utilisation de l’insuline par les cellules. Chez ces patientes, le risque de développer un cancer de l’endomètre est environ 2 fois plus élevé que chez une femme non diabétique. C’est principalement la résistance à l’insuline et l’hyperinsulinémie qui sont en cause. En effet, cette hormone semble stimuler l’endomètre par l’intermédiaire de facteur de croissance mais aussi en augmentant le taux d’œstrogènes circulants (Raglan, 2019).
Le diabète de type 1 est dû à une absence de sécrétion d’insuline par le pancréas. Chez ces patientes, le risque de développer un cancer de l’endomètre est environ 1,5 fois plus élevé que chez une femme non diabétique. Les mécanismes en jeu sont cependant moins bien identifiés. L’hyperglycémie est une explication possible, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse (Carstensen, 2016).