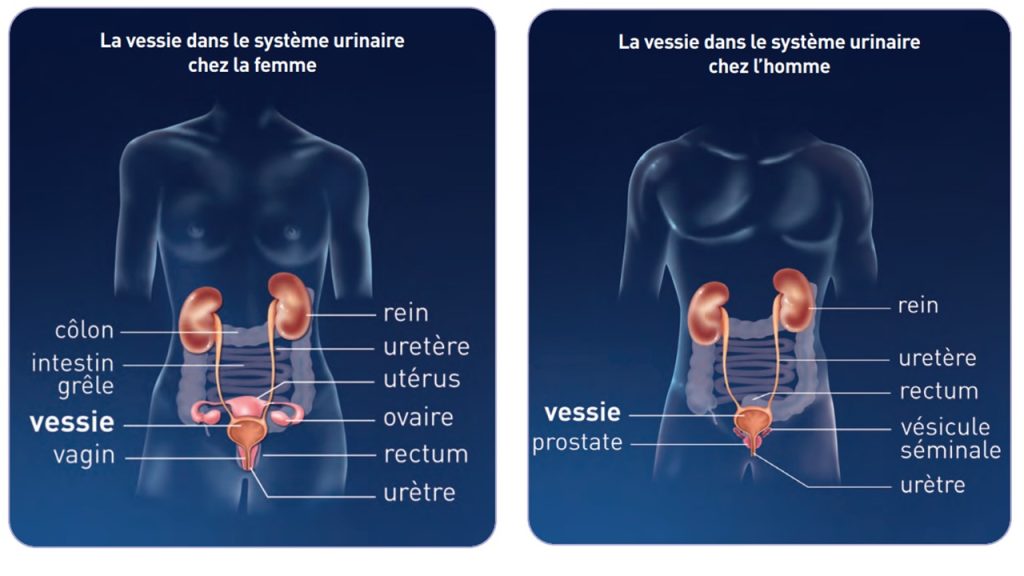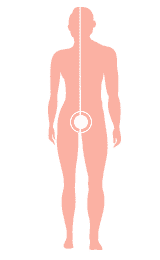Facteurs de risques individuels
Age
Il existe un net accroissement du nombre de cas de cancer de la vessie avec l’âge. Respectivement 85% des hommes atteints de tumeurs de vessie ont plus de 60 ans et 43% plus de 75 ans (ces chiffres sont de 89% et 61% pour les femmes).
Facteurs génétiques et antécédents familiaux
Les personnes dont plusieurs membres de leur famille ont eu des cancers de la vessie présentent un risque supérieur de présenter eux même un cancer de vessie. La cause est que toute la famille est exposée aux mêmes cancérogènes, par exemple chimiques ou à l’exposition au tabac.
Il peut également y avoir des mutations génétiques, par exemple du gène GST (Gluthatione-N-transférase) ou du gène NAT (N-acetyltransferase) qui rendent leur organisme plus vulnérable à certains toxiques.
Des variations acquises de certains gènes, comme le gène TP53 ou le gène suppresseur de tumeurs RB1 ainsi que les oncogènes FGFR et RAS semblent avoir un rôle important dans le développement de certains cancers de la vessie.
Certaines personnes héritent des gènes de leurs parents qui accroissent leur risque à développer un cancer de la vessie. Le cancer de la vessie n’est cependant habituellement pas une maladie familiale et les mutations géniques héritées ne sont pas une cause majeure d’apparition de cette maladie.
Facteurs de risques comportementaux
Tabac
Aujourd’hui en France, le tabac est le premier facteur de risque du cancer de vessie.
Le tabac est classé comme cancérogène certain pour l’homme par le CIRC (Groupe 1), la relation de causalité entre sa consommation et le cancer de la vessie ayant été reconnue par ses experts en 1985. La fumée de tabac contient plus de 4000 produits chimiques sous forme de particules ou à l’état gazeux, certains d’entre eux étant identifiés comme favorisant spécifiquement le cancer de la vessie, tels le benzo(a)pyrène (BaP) ou l’arsenic. Il a été estimé qu’en France, en 2000, 53% des cas de cancers de la vessie étaient attribuables au tabagisme chez les hommes et 39% chez les femmes (CIRC, 2007). L’augmentation du tabagisme chez les femmes conduit à penser que cette proportion pourrait s’accroitre.
Une enquête américaine a démontré que le tabagisme aurait un impact de plus en plus délétère sur le risque de cancer de la vessie, les fumeurs ayant 5,5 fois plus de risques de cancers de la vessie que les non-fumeurs en 2002-2004 contre 4,2 fois plus en 1998-2001 et 2,9 fois plus en 1994-1998. L’évolution du conditionnement des cigarettes et l’introduction d’additifs de plus en plus toxiques pourraient expliquer cette hausse importante (INCa, 2009).
En revanche, le tabagisme passif n’a pas fait la preuve d’un risque plus important de cancer de la vessie.
Agents infectieux
Des facteurs infectieux ont également été identifiés. La bilharziose liée au parasite Schistosoma haematobium, favorise une forme particulière (épidermoïde) de tumeurs de vessie, dans les régions où elle est endémique (Moyen Orient, Afrique) du fait d’une inflammation chronique de la vessie. Plus généralement, une irritation chronique de la vessie peut augmenter le risque de développer un cancer de la vessie (suite à des épisodes d’infections urinaires ou de calculs à répétition).
Certains médicaments
La radiothérapie pelvienne, et des médicaments qui contiennent de la phénacétine (médicaments antidouleurs), du cyclophosphamide et de la chlornaphazine (molécules utilisées dans des protocoles de chimiothérapies), sont associés à des cancers de la vessie. A noter que la commercialisation de la chlornaphazine a été précocement arrêtée pour cette raison. Ces substances sont classées comme cancérogènes certains pour la vessie par le CIRC (Groupe 1).
Facteurs de risques professionnels
La part des cancers de la vessie d’origine professionnelle est estimée entre 2% et 14%. Des estimations plus précises ont été données pour la France pour l’année 2000 : autour de 5,1% pour les hommes, et de 0,6% pour les femmes.
En milieu professionnel, deux ensembles de substances chimiques sont à l’origine de l’essentiel des cancers de la vessie reconnus d’origine professionnelle ; ce sont les seuls facteurs de risque professionnels de cancer de la vessie reconnus à ce jour en France :
Ces deux ensembles de substances chimiques sont retrouvées dans le tabac. Ainsi, fumer et être exposé conjointement à ces produits chimiques accroit le risque de développer un cancer de la vessie.
Les amines aromatiques
Ce sont des composés chimiques que l’on utilise dans la fabrication des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des pesticides, des matières plastiques, dans l’industrie du caoutchouc et que l’on retrouve dans le tabac.
Les principaux secteurs concernés par l’exposition aux amines aromatiques sont les industries du caoutchouc, de cosmétiques (coiffure et esthétique), de pesticides (fabrication du chlordiméform), l’emploi des substances colorantes (secteurs du textile, du cuir et du papier), la plasturgie, et les laboratoires de recherche, qui représentent de multiples milieux professionnels où les risques sont plus ou moins élevés (INRS, 2007)
Le tableau 15 ter des maladies professionnelles du régime général concerne les tumeurs primitives de l’épithélium urinaire (vessie et voies excrétrices supérieures) provoquées par les amines aromatiques. Le délai de prise en charge est de 30 ans.
La durée d’exposition prise en considération de 5 ans, quelle que soit le type d’exposition (depuis le décret n°2012-936 d’août 2012).
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques, souvent abrégés en HAP, sont des constituants naturels du charbon et du pétrole. Ils peuvent aussi être issus de la combustion incomplète de matières organiques diverses telles que les carburants, le bois, le tabac… Ces substances sont employées dans l’industrie du goudron, des pneumatiques ou du textile. La production et l’utilisation de ces substances sont aujourd’hui sévèrement règlementées.
Le tableau 16 bis du régime général de maladies professionnelles se rapporte à des produits incluant des HAP. Mis à jour en 2009, il désigne des expositions professionnelles à l’origine de 3 cancers dont les tumeurs de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures). Une maladie professionnelle peut être reconnue sous réserve d’une exposition de 10 ans et dans le cadre d’une liste limitative de travaux : cokerie (fours), fabrication d’aluminium, travaux sur chaudières et foyers à charbon etc. Le délai de prise en charge est de 30 ans.
Depuis novembre 2012, le tableau 35 bis du régime agricole, qui se rapporte aux goudrons, huiles, braies de houille, et suies de combustion du charbon, reconnaît les tumeurs primitives de l’épithélium urinaire (vessie et voies excrétrices supérieures). Le délai de prise en charge est de 30 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.