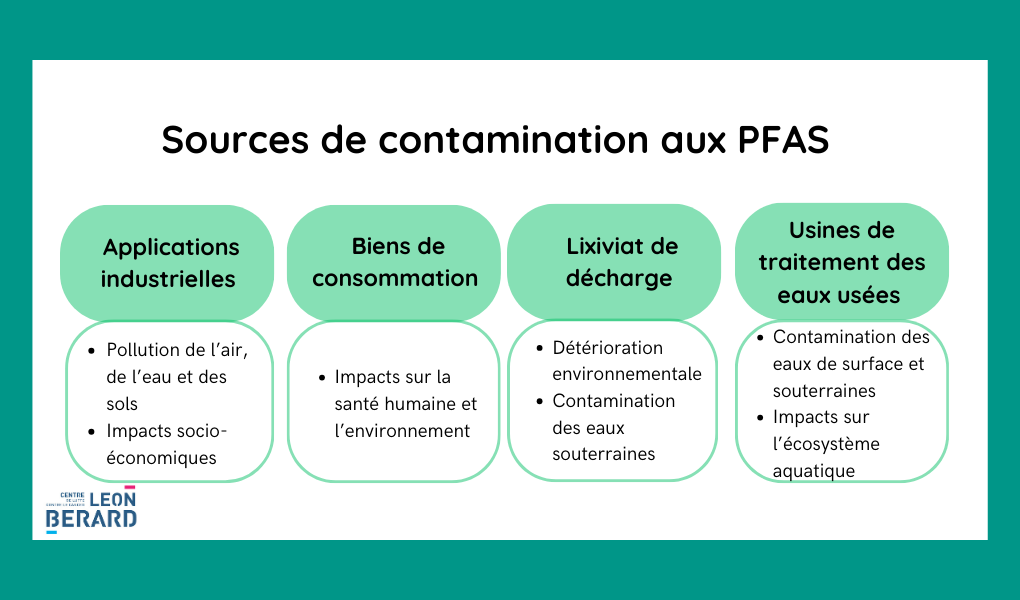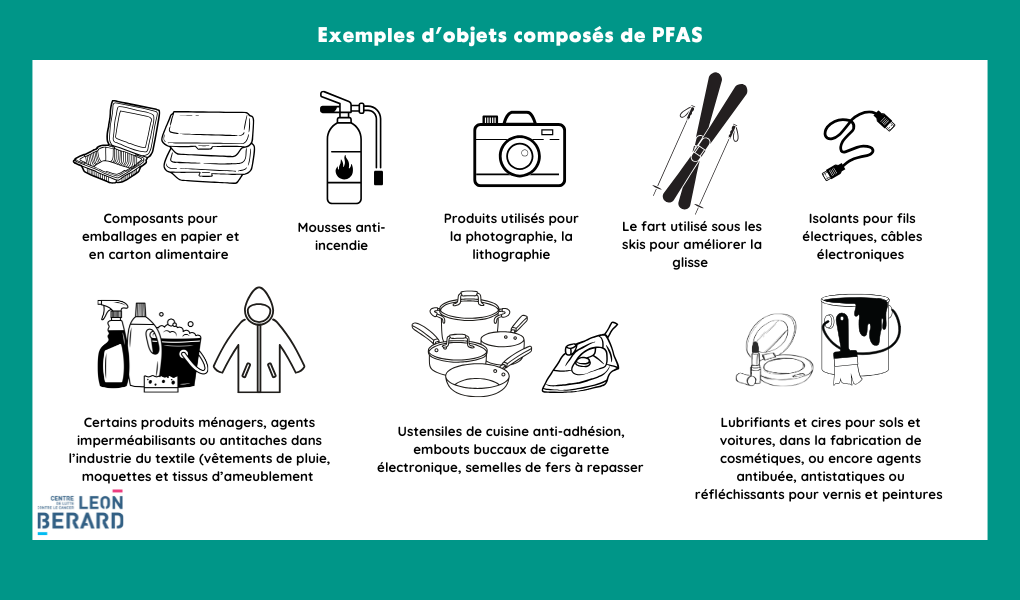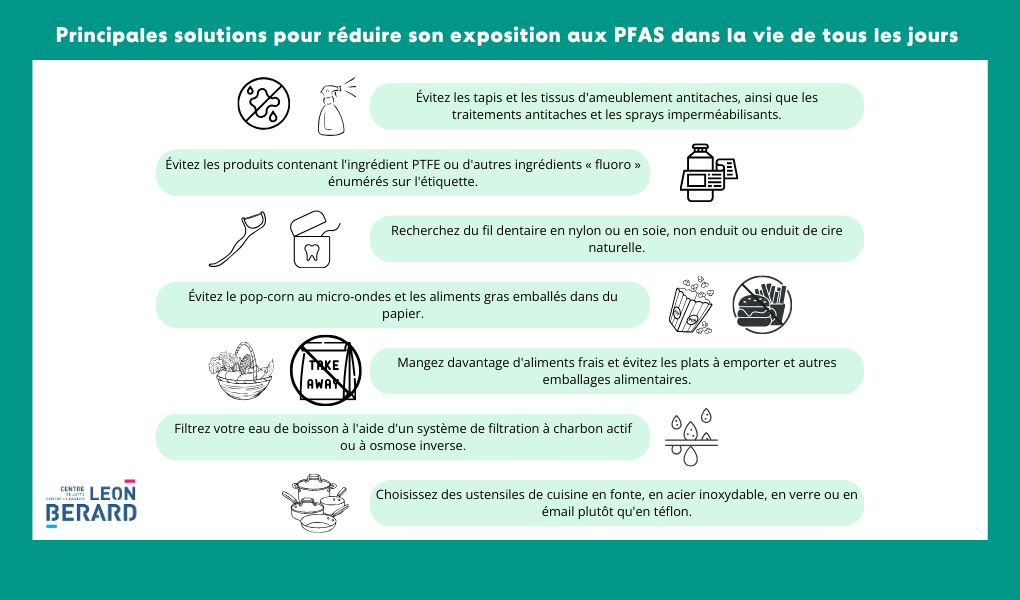Les PFAS représentent une large gamme de substances chimiques et l’évaluation de leurs impacts sur la santé reste donc très complexe.
Les PFAS sont des contaminants environnementaux omniprésents et constituent donc un facteur de risque émergent pour la santé humaine. Le temps d’élimination des PFAS est de l’ordre de plusieurs années. Or, ces temps d’élimination conditionnent la bioaccumulation. En effet, les PFAS sont accumulables dans l’organisme et actuellement la quasi-totalité de la population ont des niveaux mesurables dans leur sang, au même titre que d’autres substances chimiques (Etude ESTEBAN, 2020).
Des études menées sur des animaux de laboratoire auxquels on a administré de grandes quantités de PFAS indiquent que certains PFAS peuvent affecter la croissance et le développement, la reproduction, la fonction thyroïdienne, le système immunitaire et endommager le foie.
Cependant, les effets sur la santé humaine d’une exposition à de faibles niveaux d’exposition aux PFAS sont plus incertains pour la population générale.
Les familles et composés les plus étudiés sont les acides perfluorés carboxyliques (PFCA), dont le PFOA et les acides perfluorés sulfoniques (PFSA) dont le PFOS.
Les PFAS sont potentiellement capables de produire un large éventail d’effets néfastes sur la santé en fonction des circonstances d’exposition (ampleur, durée et voie d’exposition, etc.) et des facteurs associés aux individus exposés (par exemple, l’âge, le sexe, l’appartenance ethnique, l’état de santé et les prédispositions génétiques) (Fenton, 2020).
PFAS et effets sur le système reproducteur
Chez les hommes
Les PFAS ont la capacité d’impacter la production des hormones mâles telle que la testostérone (stéroïdogenèse). Ils peuvent faire varier la sécrétion des hormones (en l’augmentant ou la diminuant suivant le type).
Une méta-analyse combinant 11 études différentes a montré une association négative entre l’exposition au PFOS et au PFOA et les taux de testostérone masculine. Cette méta-analyse importante a démontré que l’exposition aux PFAS est significativement associée aux niveaux d’hormones de reproduction (Ling, 2024).
En 2024, une autre étude a montré que le PFOA diminuait la motilité totale et progressive des spermatozoïdes. La motilité des spermatozoïdes fait référence à leur capacité à bouger, et représente la principale cause d’infertilité chez les personnes possédant du sperme (Alamo, 2024).
Chez les femmes
De nombreuses études épidémiologiques ont identifié des associations entre une exposition élevée aux PFAS et des règles tardives, des cycles menstruels irréguliers, une durée de cycle plus longue et un âge plus précoce à la ménopause et des niveaux réduits d’œstrogènes et d’androgènes (Ding, 2020).
Récemment, une étude a montré un lien entre l’exposition aux PFAS dans les fluides folliculaires et le syndrome des ovaires polykystiques (Ding, 2020).
PFAS, développement du fœtus et santé de la mère pendant la grossesse
L’exposition aux PFAS pendant la grossesse peut augmenter le risque de complications telles que la naissance prématurée, le faible poids à la naissance et la prééclampsie. Dans la plupart des études, des concentrations plus élevées de PFOS et de PFOA étaient associées à un poids moyen à la naissance plus faible. L’exposition prénatale aux PFAS peut également jouer un rôle plus important dans la variabilité de la croissance pendant la petite enfance (Habib, 2024).
Enfin, une nouvelle étude coordonnée par l’Inserm et le CHU de Grenoble publiée le 30 Janvier 2025, ouvre la voie vers une nouvelle explication sur les effets des PFAS sur la santé de la mère et de l’enfant. Ces effets pourraient provenir en partie d’une altération du placenta. Les chercheurs ont constaté que certains de ces PFAS semblent affecter l’intégralité des villosités placentaires, structures qui assurent les échanges entre le sang maternel et le réseau vasculaire fœtal (diminution des échanges entre la mère et le fœtus pouvant entrainer une baisse des apports en oxygène et en nutriments). Une étude nationale, à plus grande échelle, permettrait de confirmer ces résultats.
PFAS et thyroïde – perturbateurs endocriniens
Les PFAS font partie des composés associés à des perturbations endocriniennes chez les humains et d’autres animaux. Le PFOA peut affecter divers organes endocriniens, notamment la thyroïde. Les PFAS sont suspectés de jouer un rôle dans le dérèglement de plusieurs mécanismes biologiques tels que la génération d’hormones thyroïdiennes mais également leur transport, leur métabolisme et leur interaction avec les récepteurs thyroïdiens (Habib, 2024 ; Boas, 2006).
Les études réalisées sur l’effet des PFAS sur la fonction thyroïdienne chez l’homme ont principalement mis en évidence une fréquence plus élevée d’hypothyroïdie due à l’exposition au PFOA autant dans la population générale que dans les communautés fortement exposées (travailleurs) (Coperchini, 2017 ; Xie, 2024).
Enfin, une revue de littérature effectuée en 2021 suggère que les preuves disponibles soutiendraient un effet perturbateur sur la thyroïde en lien avec une exposition aux PFAS d’ancienne et de nouvelle génération (Coperchini, 2021).
Toutefois, les résultats des études sur les effets des PFAS (selon le type) sur la thyroïde restent controversés. Il n’existe pas de résultats cohérents ou uniformes sur le sujet.
PFAS et effets sur le foie et les maladies inflammatoires de l’intestin
Le foie joue un rôle important dans le métabolisme et l’élimination des molécules étrangères, comme les médicaments, les pesticides ou encore certains contaminants environnementaux. Il s’agit donc d’un organe fragilisé face à l’exposome chimique.
La toxicité hépatique de certains PFAS suscite de plus en plus d’inquiétude. Les données émergentes sur la toxicologie et l’histologie animale mais également chez l’humain, fournissent des indices mécanistiques selon lesquels les PFAS perturbent le métabolisme hépatique, entraînant une augmentation de la recapture des acides biliaires et de l’accumulation de lipides dans le foie (Schlezinger, 2020).
L’exposition aux PFAS a été également associé à l’apparition de maladies inflammatoires de l’intestin. Les expositions aux produits chimiques environnementaux reconnues jusqu’alors comme pouvant provoquer une inflammation du foie (Barouki, 2023 ; Costello, 2022), ces dernières sont de plus en plus reconnues comme un facteur de risque potentiel des maladies inflammatoires de l’intestin (Durham, 2023). Une étude épidémiologique cas-témoins a démontré une association positive entre la présence de PFAS dans les sérums et le développement de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique (Steenland, 2019). Cependant les études actuelles sur le sujet admettent des résultats différents selon les analyses effectuées et le type de PFAS indiqué (Papadopoulou, 2021 ; Ho, 2022).
PFAS et survenue de maladies cardiométaboliques
En population générale, une récente revue de 2023 atteste de preuves assez cohérentes de perturbations des PFAS dans plusieurs processus importants pour la santé cardiométabolique, tels que le métabolisme lipidique et le système immunitaire. De plus, les preuves épidémiologiques d’associations entre l’exposition aux PFAS et un taux de cholestérol élevé sont relativement solides (Schillemans, 2022). Les experts de L’EFSA (autorité européenne de sécurité des aliments) ont considéré que la diminution de la réponse du système immunitaire à la vaccination constituait l’effet le plus critique pour la santé humaine (EFSA, 2020).
PFAS et cancer
En novembre 2023, un groupe de travail du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) a évalué la cancérogénicité de deux PFAS : PFOA et PFOS. Le CIRC a ainsi classé le PFOA comme « cancérogène pour l’humain » (Groupe 1) sur la base d’indications « suffisantes » de cancer chez l’animal et de « fortes » indications mécanistiques chez l’humain. Le PFOS a été classé comme « peut-être cancérogène pour l’humain » (Groupe 2B) sur la base d’indications mécanistiques « fortes ». Pour le PFOS, les indications de cancer chez l’animal de laboratoire étaient « limitées » et les indications chez l’humain étaient « insuffisantes ».
Dans l’ensemble, les preuves d’une association entre l’exposition aux PFAS et risque de cancer dans la population générale sont limitées et les résultats disponibles restent incohérents (Steenland, 2020).
Par ailleurs, il est important de souligner que tous les PFAS n’ont pas été étudiés de manière exhaustive pour leur potentiel cancérogène, et la relation exacte entre l’exposition aux PFAS et le risque de cancer peut varier en fonction de plusieurs facteurs tels que le type spécifique de PFAS, le niveau d’exposition et la susceptibilité individuelle.
Il faut noter également que les preuves les plus solides d’associations entre les PFAS et le risque de cancer résultent d’études portant sur l’exposition professionnelle.
Ces populations sont exposées à des niveaux élevés de PFAS qui peuvent ne pas être représentatifs de l’exposition de la population générale. En effet, les travailleurs des industries concernées (fabrication de produits chimiques), ou les pompiers, sont directement exposés à des niveaux élevés de PFAS, et présentent par conséquent des risques accrus de certains cancers, notamment le cancer du rein et du testicule (Bartell, 2021 ; Denic-Roberts, 2023 ; Mazumder, 2023).
Cancer du testicule
Le lien entre l’exposition aux PFAS et le risque de cancer de testicule est fortement suspecté, cependant les études portant sur ces associations sont encore limitées, et les preuves actuelles de ces relations ne sont pas encore concluantes.
Les études épidémiologiques réalisées chez les travailleurs (pompiers et fabricants de produits chimiques), ont montré une augmentation du risque de cancer du testicule, associée à l’exposition professionnelle aux PFAS. Toutefois, il convient de noter que la majorité de ces études portaient sur des groupes professionnels exposés à des niveaux très élevés de PFAS (Steenland, 2021 ; Boyd, 2022 ; Petersen, 2020).
Dans l’ensemble, bien que les études disponibles suggèrent une possible relation entre l’exposition aux PFAS et le risque de cancer du testicule, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette relation et mieux comprendre les mécanismes biologiques potentiels impliqués. L’étude en cours TESTIS, coordonnée par le Département, a pour objectif d’étudier les effets des expositions environnementales, professionnelles et domestiques aux pesticides pendant le développement in utero et la vie entière sur les risques de cancer du testicule à l’âge adulte.
Cancer du rein
Une étude suédoise ayant pour objectif d’examiner le risque de cancer du rein après une exposition de longue durée à des niveaux élevés de PFAS dans l’eau potable a montré un risque accru du risque de ce type de cancer chez les sujets ayant vécu dans des zones d’eau contaminée par des PFAS (Li, 2021).
Un risque plus de deux fois plus élevé a été observé chez les personnes fortement exposées au PFOA par rapport aux personnes faiblement exposées (Shearer, 2021).
Bien que certaines études suggèrent un lien possible entre une exposition élevée aux PFAS et un risque augmenté de développer un cancer du rein, les preuves ne sont pas entièrement concluantes, notamment à des niveaux d’exposition observés dans la population générale.
Si certaines études portant notamment sur les expositions professionnelles ont montré une augmentation significative du risque de cancer des reins, d’autres études n’ont pas trouvé de lien significatif.
Par ailleurs, les mécanismes exacts par lesquels les PFAS pourraient contribuer au développement du cancer du rein ne sont pas entièrement compris.
Cancer du sein
Une augmentation du risque de cancer du sein (NB : faire lien fiche portail) en lien avec l’exposition aux PFAS (notamment avec les sous types de PFOS, PFHxS et PFUnDA), a été rapporté dans un certain nombre d’études. Une analyse portant sur la cohorte prospective Française E3N-Génerations a mis en évidence une relation entre l’exposition aux PFOS et le risque de cancer du sein, uniquement pour les sous types de cancer du sein positif aux récepteurs d’œstrogènes et de la progestérone (Frenoy, 2022 ; Mancini, 2020).
Des associations positives pour PFOA et PFHxS et une association inverse pour le PFNA ont également été démontré. (Jiang, 2022) A l’inverse, un lien significatif entre l’exposition à 4 PFAS différents (PFOA, PFOS, PFNA et PFHxS) et risque de cancer du sein a également été montré dans une autre méta-analyse (Cong, 2023).
Toutefois, des associations positives mais pas statistiquement significatives ont été suggérées pour PFOA et PFNA lorsque on tient compte que des études collectant des échantillons sanguins pré-diagnostique au cancer du sein. Le risque variait également en fonction du statut des récepteurs hormonaux (estrogènes et progestérones) de cancer du sein et en fonction du statut ménopausique des femmes) (Chang, 2024).
Cette absence de lien significatif peut être due à l’hétérogénéité importante des études et à l’évaluation limitée de l’exposition aux PFAS pendant la période étiologiquement pertinente pour le développement du cancer du sein (notamment la puberté, pendant la grossesse).
Cancer de la thyroïde
Il convient de noter que les PFAS, à cause de leurs propriétés de perturbateurs endocriniens pourraient potentiellement perturber la fonction thyroïdienne en interférant avec les hormones thyroïdiennes, qui à leur tour peuvent contribuer à la cancérogenèse du cancer de la thyroïde.
Toutefois, peu d’études ont évalué l’association entre l’exposition aux PFAS et le risque de cancer de la thyroïde.
Dans l’ensemble, certaines de ces études ont suggéré une association entre une exposition accrue aux PFAS et un risque plus élevé de développer un cancer de la thyroïde, tandis que d’autres n’ont pas trouvé de lien statistiquement significatif (Madrigal, 2024 ; Jing, 2023).
Tous les mécanismes biologiques sous-jacents de cette association potentielle ne sont pas entièrement compris. Les travaux futurs devraient investiguer ces relations chez les personnes exposées à des niveaux plus élevés et pendant les périodes de développement précoce où la glande thyroïde est plus sensible aux effets néfastes de l’environnement.
En résumé
Dans l’ensemble, bien que les résultats soient hétérogènes, plusieurs études épidémiologiques et expérimentales ont montré une association entre l’exposition aux PFAS et de nombreuses maladies (incluant plusieurs types de cancers). Ces effets sur la santé sont d’autant plus notables dans le cadre d’expositions professionnelles où l’exposition aux PFAS est plus élevée.
L’hétérogénéité des résultats observés dans les différentes études et la complexité de la relation entre PFAS et santé peuvent être influencés par plusieurs facteurs (conception des études, design des études épidémiologiques, populations évaluées et méthodes de mesure de l’exposition aux PFAS).
En outre, à cause de à leur variabilité au niveau de leurs composés et de leurs différentes propriétés, les composés de PFAS peuvent avoir des effets variables sur le risque de chaque type de maladie. De plus, les effets de l’exposition aux PFAS sont complexes et ne dépendent pas uniquement de la concentration et de la structure des PFAS, mais aussi de l’âge et du sexe des personnes exposées.
Ces différences peuvent conduire à des résultats divergents et rendent difficile l’affirmation de conclusions définitives. Les études futures, notamment les recherches longitudinales et les investigations approfondies des mécanismes biologiques pourraient contribuer à mieux comprendre les rôles clés des PFAS.